
DE LA CAFEINE DANS NOTRE COCA COCA
" C'est toi, divin café, dont l'aimable liqueur,
Sans altérer la tête, épanouit le coeur "
– DELILLE (1738-1813)
D'après nos recherches, le Coca Cola est une boisson contenant de la caféine.
Qu'en est-il vraiment ?Nous avons fait l'expérience !
Qu'est ce que la caféine ?
À l'origine, l’effet stimulant du Coca-Cola ® était produit par la cocaïne contenue dans les feuilles de coca ainsi que par la caféine des noix de kola. En 1886, un verre de Coca-Cola ® contenait 9 milligrammes de cocaïne. En 1906, et jusqu'en 1929, le Coca-Cola ®, vendu comme tonique pour le cerveau, fut quasiment privé de cocaïne. De nos jours, la feuille de coca est toujours utilisée : en 2002, 159 tonnes de feuilles de Coca ont été achetées à la Bolivie pour subir une « décocaïnisation »... Il semblerait que la technologie ait supprimé toute trace de cocaïne du Coca-Cola ®. La caféine reste néanmoins présente dans le Coca-Cola ®. Le nom de la caféine provient du café où elle a été identifiée pour la première fois par le chimiste allemand Friedrich Ferdinand Runge, en 1819. Celui-ci la nomma « kafein » en tant que composé chimique du café. Oudry découvrira plus tard, en 1827, la théine, qui se révélera être la même molécule que la caféine, comme le démontreront Gerardus Mulder et Jobat, en 1838. La caféine, de formule brute C8H10N4O2, est un alcaloïde faisant partie de la famille des méthylxanthines. Cela signifie que la caféine est une substance organique azotée, d'origine végétale, à caractère alcalin (c'est à dire basique), et présentant une structure complexe. Sous sa forme pure, la caféine se présente sous la forme d'une poudre blanche au goût particulièrement amer.
Molécule de caféine
La consommation de caféine
Présente dans de nombreux aliments, la caféine est la molécule psychoactive la plus populaire avec une consommation mondiale estimée à cent vingt mille tonnes par an. Elle est notamment consommée via le café, le thé mais aussi, et de plus en plus, dans les boissons gazeuses.
Par exemple, aux USA, d'après "Substance Abuse, A comprehensive textbook", les boissons gazeuses sont devenues la principale source de caféine depuis le milieu des années 1970.
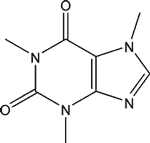


À l'origine, la caféine était présente dans le Coca-Cola ® grâce à l'utilisation de noix de kola, graine d’un arbre, le Kolatier, poussant notamment en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, la caféine subsiste dans cette boisson à l'état de synthèse. Son taux est réduit, d'après nos recherches, 102mg/L, mais est suffisamment élevé pour que la boisson conserve sa dimension stimulante.
Les effets de la caféine
Métabolisation de la caféine
Après ingestion, l'absorption de la caféine se réalise dans le tube digestif (20 % par l'estomac et 80 % par l’intestin).
La caféine est principalement métabolisée au niveau du foie (à 80 %), qui reçoit le sang de la veine porte (celle-ci apportant des substances provenant de l'estomac et des intestins, mais aussi de la rate et du pancréas, qui seront transformées par le foie). Elle y est donc dégradée par le système enzymatique cytochrome P450, qui éliminent les groupes méthyles CH3 de la caféine : l'atome d'azote étant plus électronégatif que l'atome de carbone, la liaison CH3 -N est fragile, ce qui entraîne la rupture de la liaison CH3 -N lors d'une réaction chimique. Ce réarrangement de la structure de la caféine transforme cette dernière en trois molécules isomères :
-
la paraxanthine
-
la théobromine
-
la théophylline
(Ces molécules sont à leur tour métabolisées et excrétées dans les urines par la suite.)

Les mécanismes d’action ainsi que les effets de la caféine sur l’organisme sont donc imputables tant à la caféine elle-même qu’à ses métabolites. Elle se distribue et se diffuse facilement dans l’organisme, à travers le sang, c'est pourquoi ces effets sont rapidement observables.
La présence de caféine dans le corps
La concentration de caféine dans le sang après ingestion de café, de Coca-Cola ® ou de thé à une concentration en caféine similaire, après 30 minutes, si nous buvons du thé ou du café alors que si nous buvons du Coca-Cola ®, la caféine met plus de temps à passer dans le sang (le sucre ralentit l’absorption de la caféine). Son pic de concentration dans le sang est donc atteint entre vingt minutes et deux heures.

La demi-vie, qui mesure le temps de présence de la caféine dans l’organisme, est en moyenne, chez un adulte en bonne santé, de 2,5 à 4,5 heures. La durée nécessaire au corps pour éliminer la moitié de la quantité initiale de caféine varie en fonction des individus selon des facteurs tels que l'âge, le fait d'être enceinte (la demi-vie est alors d'environ neuf à onze heures) ou non, la prise de certains médicaments, le niveau d'activité dans le foie des enzymes nécessaires au métabolisme de la caféine ou encore la consommation de la cigarette. Ainsi, chez les fumeurs, la demi-vie de la caféine diminue de 30 à 50 %. D'autre part, chez les jeunes enfants, la demi-vie peut aller jusqu'à trente heures.
Son action sur le cerveau
La caféine atteint le système nerveux par le sang dans les 5 minutes qui suivent l'ingestion, ce qui explique sa rapidité d’action. La caféine traverse facilement la barrière hémato-encéphalique qui sépare la circulation sanguine du cerveau du reste du corps. La caféine est un psychostimulant, c'est-à-dire un excitant psychique qui augmente l'activité du dispositif nerveux en facilitant ou perfectionnant certaines fonctions de l'organisme.


Son principal mécanisme d’action comme stimulant du système nerveux central tient à son action par antagonisme des récepteurs de l’adénosine.
En effet, l’adénosine est une substance chimique naturellement sécrétée par l’organisme qui agit comme neurotransmetteur du système nerveux central. Ce « messager » agit dans la régulation de l’activité cérébrale et module l’état d’éveil et de sommeil (il s’agit en fait d’un « signal de fatigue »). L'adénosine possède des récepteurs spécifiques qu'elle active, ce qui a pour effet de causer l'endormissement. En effet lorsque l’adénosine se fixe sur ses récepteurs, il permet de réguler le sommeil en ralentissant l’activité nerveuse. L'adénosine facilite donc le sommeil et dilate aussi les vaisseaux sanguins, pour assurer une bonne oxygénation lorsque nous dormons.
Or, la caféine est un antagoniste des récepteurs de l'adénosine. En effet, la caféine a une structure similaire à celle de l'adénosine et peut donc se fixer aux mêmes récepteurs qu'elle. Cependant elle ne les active pas et ne réduit donc pas l'activité neuronale. La caféine maintient donc l'organisme en éveil et diminue la sensation de fatigue.
La caféine est donc un inhibiteur compétitif de l'adénosine.

Ci-dessous : la mise en évidence du fonctionnement de l'adénosine seule (à gauche) et de l'adénosine avec la caféine (à droite)

Conséquences sur le corps
a) Les effets d'une consommation modérée de caféine
Grâce à ce mécanisme, la caféine provoque l'augmentation de l'activité nerveuse avec la libération d'adrénaline et l'augmentation des niveaux de dopamine.
L'adrénaline a une action essentiellement excitatrice sur le système nerveux ; elle va augmenter le niveau d'attention et donner une sensation d'énergie à tout l’organisme. La caféine peut donc influencer le sommeil, en ce qui concerne sa durée et sa qualité. De plus, l'adrénaline cause plusieurs effets, notamment sur le système cardiovasculaire en augmentant le rythme cardiaque, ce qui induit des effets sur la contractilité du cœur, sur la pression artérielle, et sur l'apport du sang aux muscles. L'afflux sanguin provoqué dans l'abdomen augmente la vitesse d'absorption des nutriments contenus dans les aliments. Par ailleurs, l'expérience consistant à faire boire à deux cobayes à jeun du Coca Cola ® n'a pas permit de mettre en évidence une quelconque augmentation du rythme cardiaque ni de la pression artérielle.
D'autre part, la caféine affecte la vasomotricité, c'est à dire la capacité que possède une artère à moduler son calibre : elle provoque une vasoconstriction (les vaisseaux sanguins deviennent plus petit) mais aussi une vasodilatation (c'est à dire la dilatation des vaisseaux sanguins, l'effet inverse de la vasoconstriction). En effet, la vasoconstriction est une conséquence du blocage de l'adénosine et donc de la libération d'adrénaline qui provoque une contraction des muscles lisses des artérioles.
D'autre part, en s'opposant à l'inhibition de l'adénylcyclase, la caféine (ainsi que son métabolite la théophylline) provoquent une augmentation d'oxyde nitrique NO, un neurotransmetteur gazeux qui déclenche le relâchement des muscles lisses des vaisseaux sanguins. De plus, en bloquant l'adénosine, la caféine fait augmenter la concentration d'une molécule messagère de signalisation : l'AMPc, l'adénosine monophosphate cyclique. Cette dernière est habituellement inactivée par une phosphodiestérase, une enzyme catalysant la transformation de l'AMPc (forme active) en AMP (forme inactive). L'AMPc est aussi responsable de la vasodilatation, et le fait que la caféine permette l'inhibition de l'adénylcyclase et les phosphodiestérases augmentent la production d'AMPc et limitent sa destruction. En revanche, pour obtenir l'inhibition des phosphodiestérases, il faut une concentration de caféine plus élevée que celle nécessaire pour inhiber l'adénylcyclase. Cependant, la constriction des vaisseaux sanguins dépend, comme toujours, des individus.
Quant à la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui a notamment pour effet d'augmenter la pression artérielle. D'après certaines études, l’élévation de la pression artérielle a plus souvent été observée chez les personnes n’ayant jamais consommé de caféine, chez les sujets plus jeunes et après des apports élevés en caféine.
Il ne faut pas oublier les effets produits par les métabolites de la caféine : la paraxanthine augmente la lipolyse (dégradation des lipides) en accroissant les contractions de la vésicule biliaire et accroissant ainsi les sécrétions de sels biliaires. Cette lipolyse plus importante entraîne de plus grandes concentrations de glycérol et d'acides gras dans le sang. La théophylline détend les muscles lisses des bronches, ce qui contribue à faciliter le passage de l'air dans les poumons, et la théobromine dilate les vaisseaux sanguins et augmente le volume urinaire. Ainsi, la caféine est diurétique, et cet effet est recherché des sportifs car il permet d'éliminer les déchets stockés par l'organisme. En outre, une concentration élevée de sucre est aussi à l'origine d'une augmentation de la diurèse : les reins tentent d'expulser l'excès de sucre du sang et draine donc l'eau. Cette diurèse provoque des pertes en calcium et en magnésium mais celles-ci sont minimes et sont facilement contrebalancées par les apports d'une alimentation équilibrée.
Néanmoins, de tels effets ne sont observables qu'à partir d'une certaine dose de caféine. D'après nos recherches, il faudrait environ 400 mg par jour pour en ressentir les effets. Des doses de caféine comprises entre 100 et 600 mg permettent néanmoins d'obtenir une sensation de réveil.
b) Accoutumance et addiction
La caféine est à l'origine de nombreuses conséquences sur le fonctionnement de l’organisme mais ceux-ci sont minimes et dépendent des personnes ainsi que de leur tolérance à la caféine. Aussi l'organisme peut-il s'adapter à la présence de caféine dans le corps chez un individu qui en consomme en grande quantité, en augmentant le nombre de récepteur sensibles à l'adénosine. Ainsi l'organisme s'habitue à une forte consommation de caféine et s'accoutume : pour une même dose de caféine, ses effets sont réduits : les propriétés stimulantes de la caféine affectent moins les consommateurs réguliers que les consommateurs occasionnels. Cette accoutumance ne se développe qu'avec une consommation régulière et importante de produits contenant de la caféine.
En revanche, lors d'un arrêt brutal de la consommation de caféine, la hausse du nombre de récepteurs à l'adénosine accroît l'efficacité de celle-ci. Cela peut donc induire des céphalées dues à la dilatation des vaisseaux sanguins dans la boite crânienne, mais aussi un état de somnolence. Elle peut également causer anxiété, excitation, insomnie, diurèse ou encore troubles gastro-intestinaux. D'après l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments, une consommation individuelle de 400 mg par jour – soit quatre litres de Coca-Cola ® – ne présente pas de risque pour un adulte en bonne santé. Par ailleurs, il est recommandé d'abaisser la consommation journalière à 200 mg pour les femmes enceintes et allaitantes. Une intoxication à la caféine peut survenir par la prise prolongée d'une quantité de caféine supérieure à 600 mg par jour. Des quantités supérieures à 2 000 mg peuvent provoquer de l’insomnie, des tremblements et l’accélération de la fréquence respiratoire. Toutefois, chez les personnes sensibles, ces symptômes se manifestent parfois à des doses plus faibles. Ainsi, ses effets, qu'ils soient importants ou non du point de vue physiologique et perceptible dépend de plusieurs facteurs.
Par ailleurs, il est difficile d’établir un lien précis entre la quantité de caféine et les effets de celle-ci sur la santé car la tolérance à la caféine varie beaucoup d’une personne à l’autre. Chez l’enfant, qui ne consomme normalement ni thé, ni café, les boissons gazeuses comme le Coca-Cola ® peuvent représenter des apports équivalant à 5,3 mg par kilo de poids corporel par jour. Cela peut entraîner des changements de comportement transitoires de type agitation, irritabilité, nervosité ou anxiété.
La caféine présente quelques caractéristiques qui pourraient permettre de la considérer comme une drogue, telles que sa capacité à provoquer la sécrétion de dopamine dans certaines régions du cerveau, mais son faible potentiel addictif aux doses habituellement consommées ne permettent pas de la classer dans la catégorie des drogues. Toutefois, la caféine ne s'accumule pas dans l'organisme et ses effets sont de courte durée.
